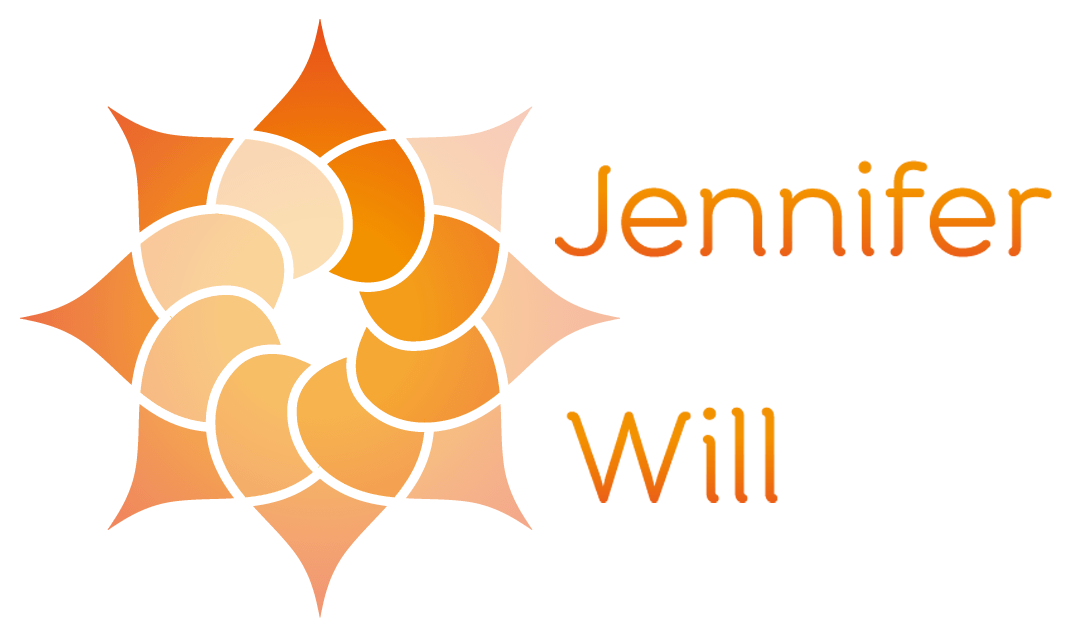Depuis toujours, l’être humain rêve de voler. Comme les enfants qui s’inventent des ailes avec du carton, nous cherchons des moyens de dépasser nos limites. Mais certaines lois — physiques ou anatomiques — restent inamovibles. Et c’est aussi ce qui rend nos explorations belles et créatives.
🛩️
Dans le yoga, beaucoup d’élèves me disent leur frustration : « Je pratique depuis des années, mais cette posture-là, rien à faire, ça ne passe pas ! » Ce n’est pas toujours un manque d’effort, ni même un problème de souplesse. Parfois, c’est simplement la charpente osseuse qui ne permet pas d’aller plus loin.
Un ami me confiait récemment qu’après huit ans de pratique, sa souplesse n’avait pas beaucoup évolué (et je confirme). Probablement parce qu’il est face à la réalité de sa morphologie : des os emboîtés d’une certaine manière, qui ne lui permettront jamais de coller son tronc à ses jambes dans certaines postures. Vous êtes peut-être, vous aussi, dans ce cas : malgré toute votre motivation, certaines postures resteront inaccessibles — et ce n’est pas un échec.
Car le yoga n’est pas une course à la performance, mais une rencontre avec soi-même. À un certain âge, d’ailleurs, beaucoup de pratiquants découvrent que leur pratique doit évoluer : le corps ne fait plus les “trucs fous” de la jeunesse, mais ouvre d’autres richesses.
C’est pour donner des repères clairs sur ces limites — naturelles, structurelles ou pathologiques — que j’ai lancé cette série d’articles sur l’anatomie et le yoga. Nous verrons ensemble :-
- quand ce sont les os qui limitent,
- l’hyperlaxité et l’hypolaxité,
- les différences entre populations,
- et aussi les blessures liées à des postures poussées trop loin.
- Śīrṣāsana (équilibre sur la tête) : posture Roi ou menace pour la nuque ?
Mon souhait est de vous aider à comprendre ce qui se joue dans le corps, pour que votre pratique soit lucide, sécurisée et créative, sans culpabilité ni comparaison inutile.

Lieu : Université Populaire Européenne
Photo : usage réservé
Ces différences d’accessoires, d’inclinaison et d’amplitude sont exactement ce dont je vais vous parler dans cette série.
Je suis professeure de yoga depuis 2009. Chaque semaine, j’accompagne une centaine de personnes, chacune avec son histoire et sa manière unique d’habiter le mouvement.
Mon parcours dans la recherche scientifique m’a appris à questionner, chercher des preuves et croiser mes observations avec les découvertes de la recherche. J’aime garder cette rigueur tout en restant dans une approche humaine et sensible.
Je ne donne pas d’avis médical et je n’établis pas de diagnostic : mon rôle est d’ouvrir des pistes de réflexion, de partager des clés de compréhension, et de rappeler qu’il est toujours possible de consulter un·e professionnel·le de santé en cas de besoin.
Dans le yoga comme dans l’écriture, mon intention est d’accompagner sans blesser, avec la conscience que chaque corps a son histoire et ses fragilités.

Image : enfant aviateur — Source : Canva (usage réservé)